Vous êtes ici : Accueil --> Découvrir --> Le village --> Le parc naturel régional des Landes de Gascogne

LE PARC NATUREL REGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE : DE LA FORET AU BASSIN D'ARCACHON
 Bourideys, commune du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Son appartenance au parc est liée à la zone septentrionale de son territoire,
dont la pente dirige les eaux de ses ruisseaux et de ces lagunes, vestiges résiduels de l'ère glaciaire, vers le bassin de la Leyre qui se déverse en un vaste delta dans le bassin d'Arcachon.
Bourideys, commune du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Son appartenance au parc est liée à la zone septentrionale de son territoire,
dont la pente dirige les eaux de ses ruisseaux et de ces lagunes, vestiges résiduels de l'ère glaciaire, vers le bassin de la Leyre qui se déverse en un vaste delta dans le bassin d'Arcachon.
UN TERRITOIRE FRAGILE
Au coeur du plus grand massif forestier d'Europe, à proximité de la côte Aquitaine, le Parc Naturel régional des Landes de Gascogne constitue l'un des nombreux parcs régionaux que compte le territoire français.
 Situés sur des zones naturelles remarquables, habitées, mais fragiles,
ces parcs sont l'expression d'une volonté d'équilibre
entre le développement et la préservation du patrimoine naturel et culturel.
Situés sur des zones naturelles remarquables, habitées, mais fragiles,
ces parcs sont l'expression d'une volonté d'équilibre
entre le développement et la préservation du patrimoine naturel et culturel.
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne a été créé en 1970, sur les départements des Landes et de la Gironde. Il regroupe 40 communes, dont Bourideys, concerne environ 40000 habitants. Englobant les deux Leyre, depuis leurs sources, jusqu'au delta qui se perd dans le bassin d'Arcachon, il s'étend sur une superficie de 262000 hectares, faits de sable, de forêt et d'eau, la forêt landaise, "cette province des arbres dont les cimes font un bruit de mer dans le ciel".
 DE LA LANDE A LA PINEDE
DE LA LANDE A LA PINEDE
Jadis ce vaste plateau pauvre et acide, inondé de l'automne au printemps, sec et chaud en été offrait un paysage de lande (bruyère, genêt, ajonc, molinie, fougère, chênes pédonculés) propice à l'élevage du mouton qui trouvait naturellement sa nourriture. On y cultivait aussi le seigle et le millet.
Puis sous le Second Empire,
intervient la décision d'assainir ce vaste marécage
que constitue la Grande Lande. Assainissement qui sera obtenu
par le creusement de collecteurs d'évacuation des eaux
et par un vaste programme de boisement des landes communales et de fixation des dunes.
Très vite, des dizaines de milliers d'hectares de pins sont ensemencés.
 Le paysage s'en trouve transformé et l'économie
locale, plutôt pastorale, se tourne alors vers l'exploitation de la forêt. Le résinier
remplace le berger.
Le paysage s'en trouve transformé et l'économie
locale, plutôt pastorale, se tourne alors vers l'exploitation de la forêt. Le résinier
remplace le berger.
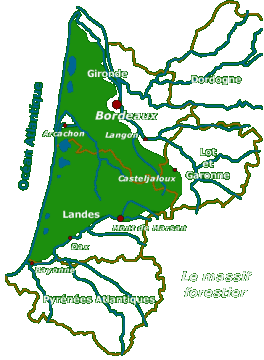 Après un siècle de plantation, la forêt de pin maritime
couvre 1 million d'hectares et constitue le plus vaste massif
forestier d'Europe.
Après un siècle de plantation, la forêt de pin maritime
couvre 1 million d'hectares et constitue le plus vaste massif
forestier d'Europe.
AGRICULTURE MODERNE
A partir des années
soixante, une nouvelle activité prend de l'ampleur, avec l'apparition d'exploitations
agricoles de surface importante, qui savent le parti qu'elles peuvent tirer d'un sol
sableux et d'un climat chaud et ensoleillé, aidée par une irrigation de plus en plus
automatisée (pivots et rampes) et une mécanisation poussée.
 Après deux décennies de monoculture de maïs,
l'heure de la diversification a sonné avec l'apparition
des cultures légumières et industrielles.
Après deux décennies de monoculture de maïs,
l'heure de la diversification a sonné avec l'apparition
des cultures légumières et industrielles.
PAYSAGES DU PARC
Ce mélange de géographie et d'histoire fait ressortir les quatre types de paysages qui se partagent l'espace du Parc, modelés tant par les hommes que par les éléments:
- La Leyre
- Le delta de la Leyre
- La forêt
- Les cultures
LA LEYRE
Le plateau landais est creusé
de nombreuses vallées où coulent des ruisseaux aux
eaux claires de couleur fauve, "les eaux rouille". La
Leyre, véritable petit fleuve intérieur, résultant
de la réunion de la Petite Leyre et de la Grande Leyre,
qui prennent leur source dans les Landes, se déverse dans
le bassin d'Arcachon après avoir parcouru 100 km dans un
lit de sable.
Bordée de feuillus formant
une voûte d'espèces variées (chênes
tauzin et pédonculés, frênes, châtaigniers,
saules), avec à leurs pieds une fougère magestueuse,
l'osmonde royale, l'impression qui se dégage des
lieux n'en est que plus secrète, tant la lumière
est particulière et l'atmosphère ouatée.



La rivière cotoie de vastes zones marécageuses inondables, animées par une vie intense : herbiers et nénuphars, libellules, cistudes d'Europe (tortues),loutre, vison d'Europe et genette, brochets, hérons canards, martin pêcheurs, grand gibier qui voit en ces lieux un refuge.
La présence de l'homme a laissé de nombreuses traces : vieilles églises du "Grand Chemin" sur la route de St Jacques de Compostelle, fontaines et moulins, antique piquetage des berges pour le flottage des bois, anciennes prairies retournées au taillis.
Les vallées de La Leyre, qui avec son delta, comptent parmi les milieux les plus riches du sud-ouest, constituent un patrimoine naturel, culturel et paysager fragile, que des activités de loisirs comme le canoé-kayak, la randonnée ou le vtt, permettent de découvrir remarquablement.
LE DELTA
A 80 kilomètres de ses sources, la Leyre quitte son tunnel de verdure et ses eaux douces,
pour se ramifier en de multiples chenaux, se mélanger à l'eau salée du bassin d'Arcachon pour constituer le delta.
Ici, entre des arbres isolés ou souffreteux, se developpent des plantes des milieux humides,
tels roseaux et roselières qui occupent l'espace.



Plus près du bassin, les prés salés apparaissent, les joncs et les salicornes forment de véritables tapis de plantes, véritables prairies inondables par les grandes marées. Les parties inférieures deviennent à marée basse ce que l'on appelle les vasières, regorgeant de crabes, coquillages et autres vers fouisseurs.
Cette mosaïque de zones sauvages aux eaux saumâtres, riches de flore et de faune a toujours attiré l'homme. On y retrouve de nombreuses traces de sa présence au fil des temps, du néolithique et de l'âge de fer à l'époque gallo-romaine et au moyen-âge : haches polies, urnes funéraires, vestiges de temples, "mottes féodales" . . .
Aujourd'hui encore, le paysage est façonné par l'homme. Dès le XVIII ème siècle, de grands espaces du delta furent endigués par des barrières d'argile pour se préserver des marées et permettre l'installation de marais salants ou de reservoirs pour l'élevage extensif de poisson. Depuis la dernière guerre, la charge trop lourde que représente l'entretien des bassins et des digues a entrainé le déclin de la pisciculture traditionnelle. Cependant, les 3000 hectares de la "Petite Camargue", restent un milieu privilégié, tant du point de vue historique et culturel que écologique.
Sur la route des migrations, des millions d'oiseaux y trouvent refuge et nourriture en toute période de l'année. Le Parc ornithologique du Teich permet de voir se cotoyer cigognes, canards, aigrettes, spatules, milans, rossignols et bien d'autres, en toute quiétude tant pour les observateurs que pour les observés.
Cette richesse est cependant fragile. Aussi le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, le Conservatoire du Littoral et le Conseil général de la Gironde ont-ils mis en place un dispositif de protection diversifié.
LA FORET
La forêt des Landes de Gascogne est avant tout une forêt de production.
D'abord, le gemmage permit l'exploitation de la résine pour donner le colophane et l'essence de térébentine.
Depuis un demi siècle, le massif a connu une véritable mutation.
Le perfectionnement des techniques de la sylviculture (mécanisqtion, selection des plants, . . .)
et la concurrence de la chimie (produits de synthèse) ont eu raison du gemmage.
Privée à 92 %, la forêt constitue une formidable réserve à bois,
transformée par l'industrie papetière et de sciage locale.



Une gestion intensive, ajoutée aux aménagements de la lutte contre l'incendie par l'intermédiaire des associations DFCI (fossés, pistes d'accès, pare feux, . . .) a abouti à un paysage taillé par les exigences de rentabilité économique et de sécurité civile.
Il subsiste toutefois des témoignages de l'ancienne lande humide, sous forme d'étendues de molinies dans les zones mal drainées ou mieux, de lagunes, milieux insolites aux conditions écologiques extrêmes (acidité de l'eau, variations de températures et d'oxygénation), sanctuaires d'espèces originales d'insectes, d'amphibiens ou bien d'oiseaux.
Le développement agricole et sylvicole par le drainage important qu'il suppose, a entraîné la disparition d'un grand nombre de ces lagunes et la diminution de la diversité biologique.
LES CULTURES
A partir des années soixante, de vastes surfaces agricoles ont été prises sur la forêt landaise
et représentent aujourd'hui 14 % de la superficie du parc.
Cette agriculture industrielle offre des paysages simplifiés, constitués d'étendues planes
et dépouillées, quadrillés de fossés d'écoulement, ponctués de bâtiments d'exploitation,
de silos et de pivots d'irrigation.



La maîtrise de l'eau y est primordiale, qui ajoutée à l'ensoleillement et au sol sableux, engendre des possibilités de production importante, d'abord avec le maïs, et de diversification avec la mise en place de cultures légumières et industrielles depuis quelques années (carotte, haricot, maïs doux,pomme de terre, bulbe . . .). Ces productions génèrent l'implantations d'unités de transformation non négligeable pour l'économie de la région et l'emploi local.
Après les récoltes d'automne, ces sols constituent également une réserve de nourriture pour certains oiseaux migrateurs (grues cendrées, palombes).
 La création du Parc intervient dans le souci de mettre en place un projet de préservation
et de mise en valeur du patrimoine naturel et culturel, exprimé par les communes
ayant la volonté d'assurer leur développement social et économique en veillant à la qualité
de leur environnement. Cela avec le concours de la Région, des Départements de la Gironde
et des Landes et de l'Etat.
La création du Parc intervient dans le souci de mettre en place un projet de préservation
et de mise en valeur du patrimoine naturel et culturel, exprimé par les communes
ayant la volonté d'assurer leur développement social et économique en veillant à la qualité
de leur environnement. Cela avec le concours de la Région, des Départements de la Gironde
et des Landes et de l'Etat.
Egalement dans le souci d'offrir aux visiteurs la possibilité d'appréhender la diversité du Parc,
des centres ont été créés, qui permettent de découvrir tous les aspects du milieu :
la forêt de pins et ses rivières dissimulées sous les feuillus, la diversité de la flore et de la faune de chacun des ecosystèmes
qui se succèdent entre le bassin d'Arcachon et le plateau landais,
les différents sites et monuments historiques qui témoignent de l'époque médiévale,
les lieux de mémoires ou écomusée, qui sont de véritables témoignages
sur la façon dont vivaient les gens du temps des bergers,
comment ils s'adaptèrent à la création de l'immense pignada,
ou comment évolua l'exploitation du bois et de la résine au cours des dernières décennies.
A cela s'ajoute l'opportunité de pratiquer de multiples sports nature
tels que canoë et kayak, randonnées pédestres ou équestres, vtt, cyclotourisme.
Sources :
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
http:www.parc-landes-de-gascogne.fr